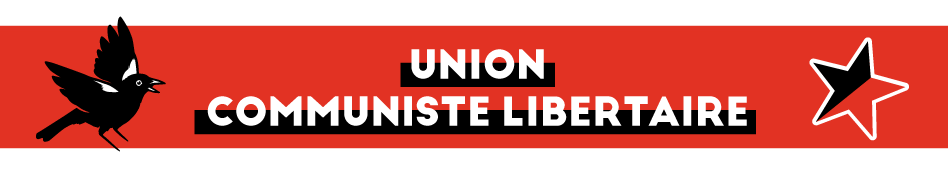États-Unis : Enchaînés à l’histoire esclavagiste
États-Unis : Enchaînés à l’histoire esclavagiste
Aux États-Unis, politiques pénales et prisons continuent à entonner l’air esclavagiste. Justifié légalement et moralement, avec ses sources d’approvisionnement, ses négriers modernes, ses défenseurs et détracteurs, l’esclavage moderne états-unien est un commerce circulaire, privé, qui commence avec la relégation et culmine avec la prison comme lieu de production.

Les formes et représentations sociales d’une culture se cristallisent généralement dès ses instants fondateurs. Un paradigme, c’est une vision du monde qui détermine les décisions, les goûts et critères d’une société et forme un pli dans le tissu culturel qui s’imprime jusque dans les mentalités, dans les inconscients. L’esclavage aux États-Unis est un tel paradigme : économiquement et historiquement fondés sur l’exploitation ultime de la force de travail, socialement organisés sur une division Blancs-Noirs, psychologiquement ancrés dans la crainte et la méfiance communautaires, les États-Unis demeurent cet endroit du monde où l’esclavage s’actualise, quoique sous des formes déguisées.
La guerre de Sécession et le 13e amendement
Pli fatal et structurant, peut-être sociologiquement indépassable malgré les luttes passées et les horreurs policières récentes, les États-Unis maintiennent l’esclavage productif – sous de nouvelles formes – parce qu’il traverse aujourd’hui encore les logiques politiques, policières et économiques.
On pourrait se croire à la veille de la guerre de Sécession. Nous sommes en 2018. Quatre millions d’esclaves ont été « libérés » à l’issue de la guerre de Sécession, en 1865. Pourtant, les mêmes schémas psycho-sociologiques demeurent, et nul modèle ne remplace le couple puritanisme-capitalisme, ou la perception d’une « différence de nature » des Afro-Américains. Comment résoudre la contradiction d’un État fondé sur des principes de liberté et d’égalité avec une réalité de lynchages et de misère, fondamentalement divisé socialement ?
Les Noirs doivent rester des esclaves pour permettre au système de se maintenir. Or le 13e amendement de la Constitution prévoit que l’esclavage et la servitude involontaire ne peuvent exister… sauf pour les criminels. Paradigme encore : il ne s’agit pas de priver de liberté seulement, mais de faire produire, de faire travailler – l’empreinte capitaliste remet « le Noir » à sa place d’esclave qui ne s’appartient pas [1]. Le tour est joué. Il suffit de criminaliser les Afro-Américains sous les prétextes les plus minces (vagabondage, musardage…) pour peupler les bagnes et « fermes d’État » d’une main d’œuvre inépuisable [2]. Cela s’effectue par les moyens législatifs et policiers habituels, mais aussi par une propagande lancinante et quotidienne, distillant l’image de personnes noires menottées, arrêtées : coupables. Aujourd’hui, la population carcérale états-unienne est la plus importante de la planète : 2,3 millions, soit un prisonnier sur quatre dans le monde.
Répression et acteurs privés
Dès 1975, Nixon puis Reagan déclarent la « guerre à la drogue », visant les activistes antisystème d’un côté, la population noire de l’autre. L’équation « Noir = drogue = criminel » est symétrique à l’addition « judiciarisation + répression + privatisation » : les deux s’équilibrent parfaitement. Le couple « surveiller-punir » de Foucault devient aux États-Unis « enfermer et produire ».
Dans les années 1980, 1990 entrent en scène les grands groupes privés de gestion carcérale. Corrections Corporation of America, par exemple, membre du puissant lobby American Legislative Exchange Council (Alec), met à la disposition des entreprises (Walmart, Boeing, AT&T) une force de travail esclave, dont l’approvisionnement est garanti par les États, chargés de garder les prisons bien remplies. Les lobbies préparent les lois pour le législateur et les font soutenir par les politiques. L’ingérence privée dans la production juridique va jusqu’à la conception de la libération sous caution, de manière à empêcher les pauvres de sortir de l’incarcération probatoire et de se défendre.
La pression sur les populations qui alimentent cet esclavage moderne est constante. Et la pression ne s’arrête pas à la sortie de prison, tous leurs droits civiques n’étant pas restitués aux anciens et anciennes détenues, qui demeurent administrativement et socialement stigmatisé.es – droits de vote, parentaux, accès à l’éducation…
Le coût est moral et psychologique : il en résulte une société structurellement fracturée, méfiante, où l’apartheid est inscrit dans les schémas mentaux et continûment actualisé. Des cellules familiales massivement privées du conjoint masculin marqué comme criminel, aux revenus de ce fait réduits, n’ayant plus accès qu’à des écoles, à des hôpitaux et à des boulots de seconde zone, et où les troubles mentaux sont 20 % plus fréquents que pour le reste du pays, notamment en lien avec la violence – urbaine, policière, conjugale. Statistiquement, une personne afro-américaine sur trois ira en prison dans sa vie.
Foncièrement prédatrice, la société états-unienne veut faire de tout le champ social une occasion de profit, Les prochaines étapes ? Peut-être l’incarcération à domicile avec géolocalisation, de manière à ne pas couper les prisonniers des circuits de consommation. Mais dans ce cas, comment conserver le potentiel de production de masse des millions de travailleuses et travailleurs incarcérés, cet autre nom de l’esclave ?
Cuervo (AL Marseille)
LES TROIS STRATES DE L’HÉRITAGE
La guerre de Sécession (1861-1865) oppose le modèle du Sud agricole, esclavagiste et néo-aristocratique, à celui du Nord, industriel, urbain, bourgeois,
où c’est le prolétariat immigré d’Europe
qu’on exploite. Au lendemain de
la guerre se pose la question :
« que faire des esclaves affranchis ? »
Dans un premier temps, les Noir.es restent « caché.es », relégué.es par mépris et vexations, par une mythologie puritaine fondatrice (l’homme noir violeur de femmes blanches) les tenant
à l’écart de tout commerce avec
le reste de la société, et évidemment
par la terreur (exercée notamment
par le Ku Klux Klan).
Dans un deuxième temps, de la fin
du XIXe siècle aux années 1940-1950,
la pression démographique et l’attraction des États du Nord font déborder la population afro-américaine de sa ruralité miséreuse du Sud. C’est le grand exode vers le nord, de l’agriculture aux usines, des champs aux grandes villes. L’exode concerne quatre millions d’anciens esclaves, et s’apparente à une fuite ;
les Afro-Américains, à l’époque, sont véritablement des réfugiés intérieurs.
Dans un troisième temps, de 1873
à 1964, la mise en place de la ségrégation par les lois Jim Crow fonde en droit une société divisée en deux parties juxtaposées « par nature ».
Les autres articles du dossier :
- Edito : La sécurité sans le sécuritaire
- Réforme judiciaire : Vers la robotisation des tribunaux ?
- Europe : La forteresse est aussi une prison
- Big Brother : Un vrai partenariat public-privé
- Histoire : Police parfois, justice nulle part
- Rojava : Sécurité et justice de proximité
- Chiapas/zapatistes : Réparer plutôt qu’enfermer
- Pratiques : Affronter les violences sexistes en milieu militant
- Traiter l’agresseur sexuel par l’éducation féministe
- Et les « fous dangereux » ? Et les « psychopathes » ?