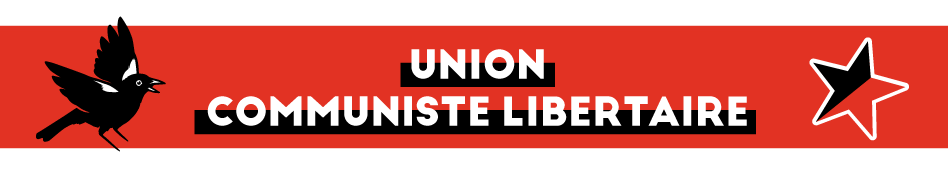Edito : Pour la décolonialité
Edito : Pour la décolonialité
Il est impossible de nier aujourd’hui les effets de la « colonialité du pouvoir », concept développé par le sociologue péruvien Aníbal Quijano. Tandis qu’en Occident la condamnation de l’agression russe contre l’Ukraine est quasi-unanime, manifester ne serait-ce que l’expression de sa solidarité avec les Gazaouies est un crime. Une équation perverse s’est installée depuis le début, en octobre dernier, de cette nouvelle séquence d’un conflit qui dure depuis 1948, et qui assimile la critique de la politique de l’État d’Israël avec l’expression d’un antisémitisme viscéral.
Pendant qu’on bataille sur le sens des mots (génocide, massacre, nettoyage ethnique, crime de guerre, crime contre l’humanité, etc.), les morts, en majorité des femmes et des enfants, alimentent un décompte macabre qui n’émeut plus guère ici. Heureusement, des campus états-uniens à Science-Po, les jeunesses se révoltent contre la complicité active des États occidentaux dans une guerre coloniale qui ne dit pas son nom. Cette jeunesse nous montre la voie.
Les événements récent en Kanaky nous rappellent que la France n’est pas seulement complice du colonialisme israélien en Palestine, elle est elle-même une puissance coloniale qui mate la rébellion des colonisées par les armes. L’État français, c’est l’état de droit ; hors de lui tout n’est que barbarie.
Le colonialisme c’est l’exploitation, le vol, la violence et la négation de l’autre. Il impose un rapport matériel et symbolique de domination : la colonialité. Elle ignore les crimes commis à Gaza ou les revendication kanak et prétend, seule, représenter le (juste) droit. C’est cette colonialité qu’il nous faut décrire, dénoncer et combattre.
UCL, 26 mai 2024