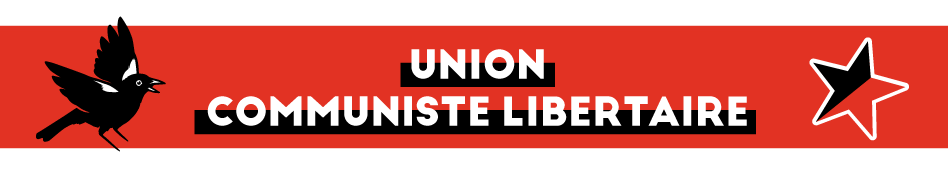Economie sociale et solidaire : Smart, ou trahir l’idée de coopérative sociale
Economie sociale et solidaire : Smart, ou trahir l’idée de coopérative sociale

Les promesses n’engagent que celles et ceux qui y croient. Et Smart, qui se voulait une alternative à l’ubérisation, l’a montré en licenciant la majorité de ses salariées en 2022. Partie d’une idée mutualiste, cette coopérative s’est lancée à la conquête des marchés avant de fuir ses responsabilités.
Smart est une coopérative franco-belge qui, du côté du siège social lillois est structurée en société coopérative d’intérêt collectif (Scic). C’est donc une entreprise classique avec un chapeau coopératif – un vernis, diront les mauvaises langues.
Ce que propose Smart, c’est du « portage salarial ». Des travailleuses et travailleurs indépendants qui ne veulent pas être auto-entrepreneurs sont juridiquement salariées par Smart, ce qui leur permet de cotiser au chômage, à la retraite, à l’assurance maladie, etc. Au passage, Smart ponctionne une commission.
Pour la théorie : très bien. Dans les faits, on est loin du compte : incompétences, désorganisation perpétuelle, surcommunication, salariées permanentes délaissées sous couvert d’« autonomie des équipes », etc. La liste des griefs est longue.
Courant 2022, c’est le choc : Smart annonce un plan de licenciement de 88% des permanentes. Officiellement on incrimine la crise sanitaire et un conflit juridique avec Pôle Emploi Spectacle ; en réalité Smart se retire de France après des années de déficit, et laisse tomber les salariées.
L’ « expérimentation », un alibi
Mais qu’est-ce qui poussait cette entreprise platement capitaliste à se prévaloir de l’« économie sociale et solidaire » (ESS) et à prétendre « refaire le monde du travail » ?
D’abord, cela permettait de faire de l’« expérimentation sociale », un concept répandu dans le secteur, qui consiste à tester des pratiques aux frontières de la légalité, puis de chercher à les injecter dans le droit – d’où, par exemple, la loi ESS du 31 juillet 2014. L’« expérimentation » fournit un alibi pour justifier un amateurisme perpétuel, puis invoquer la fatalité au moment de se débarrasser de celles et ceux qu’on a embarqué trop loin dans l’aventure.
Ensuite, c’est valorisant : l’image de coopérative démocratique avec un logo rose tape-à-l’œil permet de se différencier d’autres entreprises de portage. L’opération séduction, au sein des permanentes, marcha un temps. En fait de démocratie, le poids des votes est réparti en fonction de collèges. Pour faire court, l’ensemble des 8 750 sociétaires ne pèsent que 25% de la décision, là où cinq partenaires ou financeurs en pèsent 50%. Pas étonnant donc qu’à l’AG du 21 novembre 2021, seules 78 sociétaires aient pris part au vote.
Enfin, la structuration en coopérative n’a nullement empêché Smart Belgique de se dissocier de Smart France au moment du plan de licenciements, mené par un administrateur judiciaire, sur le périmètre exclusif de la filiale française en faillite, sans demander de comptes à la maison-mère belge, bénéficiaire sur l’exercice. Elle s’en est lavé les mains.
Malgré ces déboires, l’ambition de Smart est intacte. Dénoncer son social-washing ne signifie pas dénoncer toute l’ESS en soi – même si on peut rire de sa prétention à être une alternative au capitalisme privé et à l’État. Il y a des forces vives et des espoirs dans ce secteur, mais les garde-fous sont totalement insuffisants pour empêcher son instrumentalisation par des opportunistes vénaux.
Une ancienne salariée de Smart