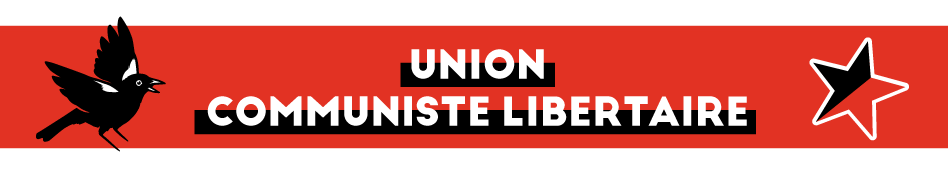Depuis 2016, de la lutte contre la loi Travail à la défense des retraites, en passant par la révolte des gilets jaunes, la combativité sociale renaît.
Il y a cent ans, le 8 mars 1917, les ouvrières de Saint-Pétersbourg (Russie) se mettaient en grève, manifestaient pour réclamer du pain et la paix et initiaient ainsi un mouvement révolutionnaire historique. Aujourd’hui, dans plus de 50 pays les femmes participent à un mouvement de grève internationale.
Chaque « grand » mouvement social résonne en partie avec les précédents tout en produisant ses propres caractères. Entamé le 5 décembre, poursuivi sans interruption depuis et appelé à débuter un acte 2 le 31 mars prochain, le mouvement de grève contre la réforme des retraites du gouvernement a déjà combiné plusieurs aspects sur lesquels il faut revenir.
Les caisses de grèves redeviennent monnaie courante dans les mouvements sociaux depuis quelques années ; certaines recueillent un tel soutien qu’elles font même les gros titres. Mais sont-elles aussi efficaces que populaires ?
Des dizaines de kilomètres au volant, chaque jour, en zone rurale, entre deux patientes. Écouter, accompagner dans leurs démarches des personnes souffrant d’un handicap psychique. Envers et malgré une institution en pleine déliquescence. Une sympathisante UCL, éducatrice spécialisée dans un service d’accompagnement en milieu ouvert, dénonce la maltraitance gestionnaire et sociétale.
Soixante-trois jours de grève, une importante perturbation des programmes : c’est le plus long conflit jamais vu dans l’audiovisuel public. Sans résultat pour l’instant, la grève redémarre en mars. Explications sur cette résistance à la démolition.
En septembre dernier, l’UCL se joignait à la campagne contre la « technopolice ». Loin d’être une lubie hors-sol, voici un exemple concret de la mise en place à Angers de la safe city.
En septembre dernier, l’UCL se joignait à la campagne contre la « technopolice ». Le retrait de la candidature de Benjamin Griveaux dissimule les véritables enjeux concernant la sur-légifération d’internet, entre autres le flicage des données et l’empilement des lois liberticides.
Derrière « l’affaire Mila » se cache une stratégie déjà éprouvée de l’extrême-droite : le pinkwashing. Celle-ci consiste à prétendre prendre fait et cause pour des personnes ou des groupes LGBTI sous couvert d’attaque contre les musulmanes et musulmans ou supposées telles, tout en promouvant un modèle de société réactionnaire, misogyne et LGBTI-phobe.
Si Brest et ses alentours restent relativement épargnés par l’extrême droite en termes d’implantation militante, des groupes fascistes s’agitent néanmoins dans la région, et le vote RN progresse ici comme dans le reste du pays. Face à cette montée des idées brunes des résistances populaires s’organisent.
Les prochaines élections municipales apportent leur lot de promesses et de tractations des différents candidates et candidats en vue d’être élues. Les communistes libertaires peuvent investir l’espace publique pour défendre leurs idées anticapitalistes et autogestionnaires. Une autre gestion des municipalités est possible, elle passera par la lutte et le changement des mentalités.
Dans les communes, le maire, qu’il soit de gauche ou bien de droite, reste un patron comme les autres, dans un système capitaliste. Même les communes dirigées par un maire PCF utilisent des faux arguments pour faire face aux revendications des employés municipaux.
En 2015, l’association antifasciste intersyndicale Visa publiait le tome 1 de Lumière sur mairies brunes aux éditions Syllepse. Vient de paraître en janvier le tome 3 qui couvre la période 2017–2019 : 236 pages et autant d’arguments contre l’extrême droite.
Face à l’enjeu crucial de l’action climatique et dans un contexte de mobilisations de la jeunesse, l’idée d’un « Green New Deal » – plan d’action climatique et environnemental – a gagné en popularité au sein des partis réformistes revendiquant une politique sociale, du Parti démocrate états-unien au Labour britannique en passant par Podemos en Espagne. Mais un tel programme nourrit aussi bien des illusions électoralistes.
Dans toutes les centrales nucléaires, même celles qui n’atteignent pas les 40 ans de durée de vie prévus à l’origine, les incidents et anomalies de fonctionnement sont légion. L’exemple de la centrale de Golfech rappelle le péril qui nous menace.
Les gigantesques incendies qui ont touché l’Australie témoignent d’une accélération de la crise climatique. Face à cela, l’émotion n’aura qu’un temps et une catastrophe en chassera une autre : plus que jamais, l’urgence est de sortir du capitalisme.
D’abord publiée par le Huffington Post, puis republié par Marianne, une tribune a suscité une importante polémique dans le milieu féministe. Et si la question n’était pas avec quelle femme on lutte mais comment lutter ensemble ?
Cette année, le 8 mars tombe un dimanche. Mais difficile de demander aux femmes qui bossent le dimanche, c’est à dire aux plus pressurées, de se mettre en grève. Il reste une autre manière de manifester nos colères et notre solidarité : pas de consommation ce dimanche.
Trois mois après le début de l’offensive militaire de la Turquie et de ses alliés djihadistes dans le nord de la Syrie, l’avenir du Rojava, où les populations kurdes et arabes s’administrent de manière autonome, est incertain.
Présenté comme « le deal du siècle » par Donald Trump, le « plan de paix et de prospérité » dévoilé le 28 janvier au côté du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est censé solutionner définitivement le conflit israélo-palestinien, sans aucune participation palestinienne et en les réduisant à presque rien.
Après la guerre des Six Jours, en 1967, la question palestinienne s’impose durablement comme sujet politique incontournable. Dans le sillage des mouvements sociaux de l’après-68, c’est dans les milieux de l’immigration postcoloniale que se créent les comités Palestine, premiers mouvements de soutien à la cause. Composés principalement d’ouvriers et d’étudiantes et étudiants arabes, ils sont dissous en 1972 et donneront naissance au Mouvement des travailleurs arabes (MTA).
Avec ce troisième tome, Alain Bihr achève sa titanesque histoire du « premier âge du capitalisme » en analysant les nombreux facteurs qui expliquent que le capitalisme émerge entre le XVe et le XVIIIe siècle en Europe occidentale, et plus particulièrement dans quelques pays seulement.
Dans ce cycle de conférences, traduites et éditées par les éditions Libertalia cet automne, l’auteur John Holloway expose le rôle central et spécifique de l’argent comme outil du capital, comme « manière de relier toutes nos différentes et respectives activités sociales et productives ».
L’auteur, Frédéric Lavignette, journaliste, a choisi de suivre une trame historique à partir d’une revue complète et originale de la presse de l’époque, toutes tendances confondues, pour retracer ces moments singuliers d’un crime politique…
Ce nouveau recueil de textes journalistiques de Victor Serge (Viktor Lvovitch Kibaltchitch, 1890-1947) vient compléter le livre Retour à l’Ouest (Agone, 2010), qui reprenait une bonne partie des chroniques hebdomadaires que l’ex-collaborateur de la presse libertaire française et espagnole, fasciné par la révolution d’Octobre et converti un temps au léninisme, avait fait paraître dans La Wallonie, un des rares journaux francophones où sa plume était la bienvenue.