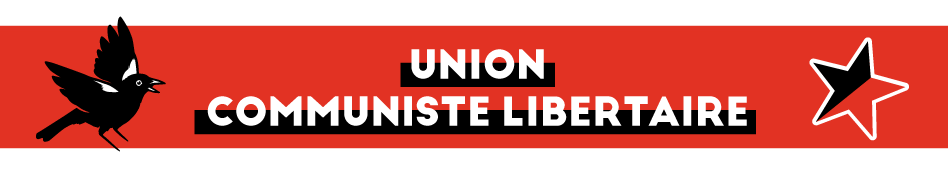Luttes LGBTI : La biphobie existe et il faut la combattre
Luttes LGBTI : La biphobie existe et il faut la combattre

Invisibilisées et accusées de ne pas faire partie de la communauté quand leur existence même n’est pas remise en question, les bies subissent pourtant plus de violences que les lesbiennes et les gays. Lutter contre l’invisibilité des bies, c’est aussi lutter contre le patriarcat.
Le 23 septembre a eu lieu la Journée internationale de la visibilité bisexuelle, ce fut l’occasion pour nous de rappeler que toutes les luttes sont encore à gagner [1] pour les personnes bies qui pourtant représenterait plus de la moitié de la communauté LGBTI [2].
TW : cet article fait mention de suicide, de violences psychiques, de viols et violences sexuelles.
Tout d’abord, commençons par un fait souvent remis en cause : oui la bisexualité existe.
Le fait que des personnes se définissent comme bi·es et revendiquent des droits ne suffisant pas, plusieurs études récentes ont ainsi été réalisé pour prouver l’existence de la bisexualité [3]. Aussi, le terme « bisexuel·le », en opposition à celui de monosexuel [4], peut désigner le fait d’être hétéros et homosexuel·le, ou le fait d’être attiré·e par des personnes du même genre et de genre(s) différent(s) [5]. La bisexualité pouvant être considéré comme un terme parapluie dans lequel se retrouverait les orientations pans et ambisexuelles.
La biphobie est le terme utilisé pour désigner l’oppression systémique envers les personnes attirées par plusieurs genres. Elle se cumule à la bi-invisibilité qui est le « manque de reconnaissance et l’ignorance des preuves évidentes que les bisexuel·les existent. » [6].
La biphobie commence ainsi par le fait de considérer comme invalide, immoral ou non pertinent, l’existence de la bisexualité et de constamment la remettre en question. Cela s’accompagne d’injonctions qui émanent des familles, de l’entourage mais aussi des partenaires qui, par dégout, jalousie, demandent à renier la bisexualité, ou se plaignent cette sexualité qui les rend anxieuses et anxieux [7]. En effet être « à voile et à vapeur », revient pour beaucoup à ne pas être des partenaires de confiance, que ce soit dans le cadre d’une relation amoureuse comme en ce qui concerne les IST et MST. Les bies étant depuis les années 1980 accusées de répandre le Sida parmi les hétéros mais aussi parmi les gays et lesbiennes [8].
Quand la bisexualité n’est pas jugée comme une curiosité malsaine d’hétéro, nommée « bicuriosité » [9] par les uns, elle est perçue comme un effet de mode passager avant de rentrer dans le rang de l’hétérosexualité. Aussi, existe-t-il des injonctions à « prouver » sa bisexualité en démontrant qu’on a plusieurs partenaires de plusieurs genres. Accepter de « prouver » sa bisexualité revient ainsi souvent à renforcer les clichés biphobes d’inconstance, qui se conjuguent à des clichés sexistes [10]. Les femmes bies étant plus nombreuses que les hommes, mais aussi le groupe le plus représenté au sein de la communauté LGBTI [11]. S’il n’est pas rare sur des sites de rencontres de croiser des annonces qui indiquent : « pas de bie » (comme peuvent le faire certaines associations gays et lesbiennes), d’autres annonces indiquent clairement rechercher des « licornes », c’est-à-dire des femmes bies qui, fétichisées pour leur sexualité, sont très recherchées pour les plans à trois [12]. La misogynie est donc motrice dans les agressions et propos biphobes.
Invisibilité matérielle
Les tenants de la biphobie reprocheront souvent aux personnes bies l’absence de données matérielles pour prouver que la biphobie existe et qu’elle fait système. Pourtant, plusieurs études existent et démontrent l’inverse.
Tout d’abord, comme pour les communautés trans, les bisexuel·les, l’invisibilisation des bisexuelles que nous pointions tout à l’heure a faussé les chiffres pendant des décennies. En effet, la majorité des études, qu’elles portent sur des statistiques de population ou sur les violences LGBTI, n’ont pas pris en considération l’existence de la bisexualité, les données ayant été englobées, sans précision, dans les statistiques sur les gays et lesbiennes. Cet effacement a de graves conséquences sur la santé des bisexuel·les, leurs besoins et moyens économiques. Par ailleurs, elles ont été un frein au financement et la création d’organisations bies [13]. Outre ce manque d’information, il est à souligner que les méthodes de Gatekeeping [14], en excluant les bies, participent à empêcher ou ralentir toute auto-organisation des personnes concernées.
Les différentes études démontrent que les personnes bisexuelles connaissent de plus grandes disparités en matière de santé que la population en général. Comparativement aux hétéros, lesbiennes et gays, il apparait que les bies souffrent plus de troubles psy, de stress, de dépression, de troubles de l’humeur ou d’anxiété. Chose que l’on peut corréler à des taux d’hypertension en moyenne plus élevés et à un plus haut risque de comportements d’addictions et de comportements à risques. Encore plus sérieux est le taux de suicides et tentatives de suicides [15], lui aussi plus haut pour les bisexuel·les [16]. Les femmes bisexuelles présentant des taux significativement plus élevés de mauvaise santé générale et de fréquents détresse mentale [17]. Pourtant, peu de programmes de santé publique s’adressent spécifiquement aux bisexuelles.

Violences conjugales
Par ailleurs, les préjugés biphobes font qu’une majorité de personnes bies ne dit pas aux professionnels de santé qu’elles et ils sont bies. Mais ce n’est pas la seule source du manque d’information et de prise en charge. En effet, le manque d’études et de formation fait que les personnels de santé comme les associations, ne peuvent correctement renseigner, accompagner et soigner les personnes bies. L’un des exemples frappant étant que la plupart des programmes de prévention du VIH et des IST ne répondent pas aux besoins de santé des bisexuel·les. Ces constations étant encore plus prégnantes dès lors que les bisexuelles ne sont pas des personnes cis.
Les chiffres démontrent que les femmes bisexuelles en relation avec des partenaires monosexuel·les ont un taux accru de violences domestiques par rapport aux femmes lesbiennes et hétéros [18]. Ainsi les femmes bies sont deux fois plus exposées aux violences familiales ; selon l’étude Virage, elles sont 47% chez les bies à déclarer avoir subi des violences - on retrouve le même déclarée par les lesbiennes, contre 19% des pour les femmes hétéros. Pour les hommes bi, ce chiffre est de 36%, contre 30% pour les gays et 13,5% pour les hétéros. Les femmes bies sont aussi celles qui déclarent subir le plus de harcèlement de rue (63 %, contre 38% pour les lesbiennes et 26% pour les hétéros) [19]. Elles sont aussi celles qui statistiquement sont le plus souvent contraintes de quitter le domicile familial, ce qui pousse dans la précarité des femmes dont on sait qu’elles sont statistiquement la population qui a les revenus les plus faibles [20].
Bisexualité et transphobie
La communauté bie est souvent accusée d’être transphobe, nous tenons à rappeler qu’être bi·e ne signifie pas être cis. De même, nous tenons à souligner que les chiffres cités au fil de ce texte ne distinguent pas les différences de vécu entre les personnes trans et les personnes cis, et ne prennent pas en compte les personnes non-binaires et leur vécu. Ce qui reste un point mort dans un champ d’analyse encore peu étudié.
Pourtant l’histoire des bi·es et des trans est très liée. En effet, l’histoire des luttes LGBTI est aussi celle de la lutte des bies et des trans qui se sont alliées contre l’invisibilité et pour leur inclusion commune dans les communautés et leurs combats. Malgré celà, comme les grandes figures trans, les figures bisexuelles ont été rayées de l’histoire. Ainsi Brenda Howard, comme Silvia Rivera, en fut effacée alors même qu’elle fut l’une des leadeuses du mouvement et, notamment, l’organisatrice de la première pride de New York. Cela n’empêche pas, encore aujourd’hui, que bies et trans soit toujours contraint·es de lutter pour être inclus et incluses au sein même des prides.
Lutter ensemble
Aujourd’hui si les mots de bisexualité ou de biphobie apparaissent dans quelques programmes politiques, c’est uniquement pour lister des LGBTIphobies sans pour autant y associer des luttes réelles ou en formation. Plus souvent encore, on ne peut lire que « gay et lesbienne » ou « gay, lesbiennes et trans » cependant l’invisibilité compte. Le besoin est criant lorsque l’on compare les réalités chiffrées à l’absence de réaction des organisations d’extrême gauche et des associations face aux divers attaques biphobes et à leur décomplexion sur les réseaux sociaux.
Lutter contre le patriarcat, c’est aussi lutter contre la biphobie
UCL Bordeaux