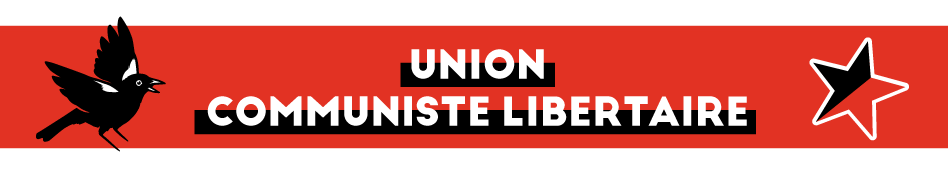Education : La bataille des mille postes, mémoire féconde
Education : La bataille des mille postes, mémoire féconde

l y a cinq ans, Saint-Denis (93) était l’épicentre d’une révolte associant enseignantes et parents d’élèves. Une mobilisation historique, qui a contraint l’État à créer plus de 1 000 postes de professeurs des écoles. Comment l’alchimie a-t-elle pris ? Retour sur expérience.
Septembre 2014 à Saint-Denis (93). Plus encore que les années précédentes, la pénurie donne des sueurs froides. Dans les 64 écoles de la ville, près de 25 classes ont fait leur rentrée sans qu’aucune enseignante n’y ait été nommée. C’est la goutte de trop. Le point de départ d’un mouvement qui va rythmer les neufs mois de l’année scolaire.
Saint-Denis (93) est la ville la la plus peuplée de Seine-Saint-Denis, un département ouvrier et métissé, notoirement sous-équipé. Le sociologue Benjamin Moignard, constatera que « le moins bien doté des établissements parisiens est mieux doté que le plus doté des établissements de la Seine-Saint-Denis » [1]. En 2013, un collectif de parents d’élèves a calculé qu’en raison des non-remplacements, chaque élève du département perd l’équivalent d’une année de scolarité entre la maternelle et et le lycée [2].
C’est la conséquence du plan de destruction lancé par Sarkozy et pas enrayé par Hollande : 80 000 postes supprimés dans l’Éducation nationale par le premier, 30 000 créés par le second… « Comment détruire un service public ? En baissant son financement, résume l’intellectuel libertaire Noam Chomsky. Il ne fonctionnera plus. Les gens s’énerveront, ils voudront autre chose. C’est la technique de base pour privatiser un service public. » [3]
Ainsi, le 2 septembre 2014, en Seine-Saint-Denis, 950 enfants prennent le chemin de l’école sans savoir qu’aucune enseignante ne les attend, principalement sur le bassin 1 (sud-ouest) et sur Saint-Denis, les zones les plus pauvres du département. Plus personne ne peut fermer les yeux sur la crise.
La mobilisation historique de 1998 en Seine-Saint-Denis, associant profs, parents et élèves, avait obtenu que le seuil maximal en réseau d’éducation prioritaire (Rep) soit de 23 élèves par classe, grâce au recrutement immédiat de 3 000 enseignantes. En cette rentrée 2014, le seuil est débordé, avec une moyenne à 24,11 élèves. Dès la première semaine, on enregistre des centaines de journées d’enseignement non remplacées. Dans un groupe scolaire du quartier du Franc-moisin, à Saint-Denis, pas moins de 5 postes sont vacants.
L’alliance parents-profs scellée dans l’action
Suite aux protestations des parents d’élèves, une première AG est réunie le 30 septembre. On y scelle l’alliance entre parents et enseignantes, pour une première action forte : le lundi 13 octobre, une dizaine d’écoles sont occupées par les parents ; l’après-midi, une centaine de parents et d’enseignantes, issu,es d’une vingtaine d’écoles, se rassemblent devant l’inspection. Après les vacances de la Toussaint est organisée une grande assemblée générale, le jeudi 6 novembre.
C’est cette AG qui va donner le véritable coup d’envoi du mouvement en décidant d’engager la grève. Comme l’écrivait Bakounine cent quarante ans plus tôt, « dix, vingt ou trente hommes [et femmes] bien entendus et bien organisés entre eux, et qui savent où ils vont et ce qu’ils veulent, en entraîneront facilement 100, 200, 300 ou même davantage » [4].
La grève doit démarrer le 20 novembre. La veille, la ministre, Najat Vallaud-Belkacem, annonce neuf mesures pour le 93, dont l’organisation d’un second concours, soit plus de 500 postes supplémentaires.

Mais cela ne désamorce pas la contestation, et la grève est suivie, à Saint-Denis, par 80 % des enseignantes ; 40 écoles sur 62 sont closes. Une manif de 600 personnes traverse la ville en partant du « ministère des Bonnets d’ânes », une friche occupée par un collectif de parents d’élèves. C’est du jamais-vu.
La mobilisation ne s’éteint pas en décembre. Certaines équipes, étranglées par le sous-effectif, affichent un « compteur des journées non-remplacées » à la porte de l’école. Plusieurs occupations sont encore organisées par les parents et les personnels. C’est le cas dans une école qui a vu se succéder sept remplaçants en trois mois sur son CE1. L’inspecteur y est séquestré, plusieurs heures durant, par des parents excédés. Résultat : un remplaçant expérimenté est illico détaché sur le poste. Autre école, autre occupation : une classe y a vu se succéder 11 remplaçantes !
Deux autres écoles sont occupées pour protester contre la perte du classement en Rep. Le 9 décembre, une grève départementale avait mis en avant les inégalités dans le dispositif Rep, et réclamé son extension à de nouvelles écoles, jusque-là sur le banc de touche. Le 16 décembre une large assemblée de ville permet de maintenir au chaud la mobilisation locale pendant les fête de fin d’année.
L’État bouche les trous en créant de la précarité
Contraint d’agir, l’État va malgré tout trouver le moyen d’utiliser la pénurie pour expérimenter une politique régressive. Au lieu créer des postes de titulaires, il va recruter des vacataires. Résultat, dès 2015, à Saint-Denis, près d’un dixième des enseignantes seront non titulaires. Et cela ne suffira même pas à boucher tous les trous.
La « gymnastique révolutionnaire », pour reprendre le bon mot d’un des fondateurs de la CGT, Émile Pouget, c’est la succession des mouvements d’émancipation, qui se renforcent les uns et les autres et forment un contre-pouvoir, préalable indispensable à la construction d’un pouvoir populaire. La décision à la base et l’action directe en sont le carburant. Les mouvements victorieux de 1998, puis de 2013, qui localement a retardé d’un an la réforme des rythmes scolaires, auront nourri la lutte de 2014-2015.
Au printemps, grève perlée et blocages d’autoroutes
Le 19 mai 2015, l’assemblée des enseignantes vote une semaine de grève. Elle sera relayée par un débrayage chaque jeudi jusqu’à la mi-juin. Toutes les écoles de la ville sont mobilisées, avec 30 à 50 % de grévistes recensés sur chaque journée, par rotation au sein des équipe. Des commissions sont créées pour organiser les actions et la communication. Les autoroutes A1, puis A86, sont bloquées par près de 250 parents, profs et élèves. Le 4 juin, un die-in (manifestanes couchées, comme mortes) devant l’inspection est accompagné de 200 silhouettes figurant les enseignantes manquantes. Le 6 juin, le lycée de la Légion-d’Honneur, monument des injustices de classe incrusté sur le territoire, est occupé. Les écoles rédigent des cahiers de doléance.

« Grévistes : participer aux initiatives de grève, participer à l’AG pour construire la suite, c’est essentiel ! » comme le clame le syndicat SUD-Éducation. Le ton est le bon, avec jusqu’à 120 personne en AG de personnels, et jusqu’à 180 en assemblées communes, qui sont le cœur de la lutte. Comme en Grèce où à Los Angeles, la victoire – 1 053 postes créés en deux ans dans les écoles de Seine-Saint-Denis, plus 470 sur l’ensemble de l’académie – aura été arrachée grâce à un front large des parents et des enseignantes, dans l’unité populaire.
L’année suivante, en mars 2016, quand on luttera contre le projet de loi Travail, l’AG interpro de Saint-Denis décidera de bloquer des axes de transports, zones portuaires et autres infrastructures économiques, dans une dynamique qui sera motrice pour l’ensemble de la région parisienne. Ce sont les grévistes de l’éducation de 2014-2015 qui proposeront cette tactique. Pas tout à fait un hasard !
Louise (UCL Saint-Denis)