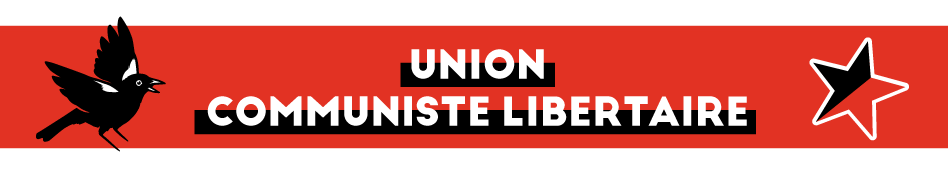Dossier 1917 : Épilogue 1918-1921 : Résistance et éradication
Dossier 1917 : Épilogue 1918-1921 : Résistance et éradication

En avril 1918, le pouvoir communiste brise les reins du mouvement anarchiste, qui devenait menaçant. Si une bonne partie des militantes et des militants se résigna à la défaite, d’autres résistèrent, voire contre-attaquèrent.
Dans la nuit du 12 au 13 avril 1918, la population de Moscou est réveillée par le crépitement des mitrailleuses. C’est la Tchéka, appuyée par plusieurs unités militaires, qui vient d’entrer en action pour briser la Fédération anarchiste communiste (FAC) et sa branche armée, la Garde noire.
Le Parti communiste – nouveau nom du Parti bolchevik depuis mars 1918 – ne pouvait plus tolérer l’existence de cet ancien allié devenu gênant et même menaçant. Les critiques politiques ou économiques, passe encore – les anarchistes étaient minoritaires dans les congrès des soviets et des syndicats, et n’y représentaient pas un danger –, mais leur refus de la capitulation de Brest-Litovsk et leur prétention à lancer une guérilla contre les troupes d’occupation austro-allemandes étaient inacceptables. Berlin aurait rendu le gouvernement bolchevik responsable de cette violation du traité de paix.
Le danger devenait palpable dans la nouvelle capitale, Moscou, où la Garde noire avait déjà formé 50 détachements aux noms poético-guerriers (Ouragan, Avant-garde, Autonomie, Tempête, Fraternité…) regroupant près de 2.000 volontaires [1].
Une campagne de presse pour préparer les esprits
Le coup de force contre les alliés d’hier, avec qui on avait lutté au coude à coude lors des journées de Juillet, contre Kornilov, pour Octobre, n’allait cependant pas de soi. On a donc préparé les esprits avec une campagne de presse frappant le mouvement libertaire à son talon d’Achille : sa difficulté à « réguler » les expropriations et à se dissocier nettement des malfrats se réclamant du drapeau noir.
La presse SR et menchevik s’est empressée de dénoncer, elle aussi, le fléau des « anarcho-bandits » [2]. Pour couronner le tout, Trotski est allé en personne galvaniser les troupes, les exhortant à sauver le soviet contre un complot de la Garde noire.

La nuit où l’assaut est donné, la police évacue 23 hôtels particuliers réquisitionnés par la FAC pour y installer des mal-logés. Près de 500 personnes sont embarquées, dont la grande majorité seront vite relâchées. Mais trois immeubles résistent, dont la Maison de l’anarchie. Bilan : 30 défenseurs tués et 12 assaillants blessés [3].
Certains militants sont exécutés après s’être rendus, notamment une figure très respectée de la FAC : Mikhail Khodounov. Ce militant ouvrier, président du comité d’usine de la manufacture de téléphones, artisan de sa mise en autogestion, délégué au soviet de Moscou, a combattu en octobre avec les libertaires du régiment de Dvinsk. La Tchéka prétend qu’il a été abattu en fuyant. Mais quand ses camarades de la manufacture récupéreront son corps trois jours plus tard, ils y découvriront des traces de torture, et une balle dans la tempe [4].
Pendant dix jours, les événements de Moscou vont avoir des répliques dans toute la Russie : Petrograd, Vologda, Voronej, Samara, Smolensk, Briansk, Taganrog… les locaux sont mis à sac, les gardes noirs désarmés, les militants emprisonnés, les journaux interdits.
Au comité exécutif panrusse des soviets (VTsIK), le libertaire Alexandre Gué proteste en vain. Le 23 avril, le VTsIK approuve la répression du « banditisme » caché « sous le masque de la phraséologie anarchiste ». Les éléments de langage sont en place. Ils ne varieront plus.
L’opération brise les reins du mouvement. Il n’est cependant pas interdit. Habilement, le gouvernement le laisse, comme d’autres, en liberté surveillée.
Les anarchistes face à trois options
Pour les anarchistes, désormais, il n’y a le choix qu’entre trois attitudes : primo, accepter et collaborer ; secundo, maintenir une action indépendante au grand jour en bravant la répression ; tertio, passer à la clandestinité armée.
1. Accepter et collaborer

La première option va être incarnée par la majorité de l’Union de propagande anarcho-syndicaliste, avec Bill Chatov et Novomirski, et par deux nouvelles organisations : la Fédération panrusse des anarchistes-communistes (1918-1921) d’Apollon Karéline, et la Section panrusse des anarchistes universalistes (1920-1921) des frères Gordine et German Askarov.
Leur ligne consistera à reconnaître la supériorité organisationnelle du Parti communiste pour défendre la révolution, tout en critiquant les « excès » de la répression d’État et de l’étatisation de l’économie. Ils y gagneront un ou deux sièges au VTsIK, et des places de fonctionnaires, notamment dans la bureaucratie syndicale. En 1921, le régime finira malgré tout par leur interdire de s’exprimer collectivement.
2. Rester indépendant en bravant la répression
Les organisations qui choisiront la seconde option survivront péniblement avec de maigres moyens, des journaux vite interdits, des militants louvoyant entre deux incarcérations. Maximov et Yartchouk, qui défendent un anarcho-syndicalisme de combat, dénoncent l’instauration d’un « capitalisme d’État » dans leur journal Volnyi Golos Trouda et animeront une opposition dans les syndicats jusqu’en 1920.

Le courant insurrectionnaliste de Bleikhman déclinera plus vite, ses forces vives ayant été aspirées par l’engagement armé contre les blancs, et diluées dans l’Armée rouge. Peu formés politiquement, sans référent organisationnel, la majorité de ces militants seront « perdus pour l’anarchisme », jugera Anatoli Gorélik quelques années plus tard [5]. Au premier semestre 1919, l’Union anarchiste-syndicaliste-communiste, créée pour coordonner les forces libertaires antibolcheviks, ne survivra pas longtemps à la répression.
C’est en Ukraine que, bénéficiant d’un rapport de forces plus favorable, les anarchistes continueront à agir le plus librement. Ainsi, autour du journal Nabat (« Le Tocsin »), une importante organisation anarchiste sera active de fin 1918 à fin 1920, en lien avec l’armée insurrectionnelle dirigée par Nestor Makhno.
3. Passer à la clandestinité armée
La troisième option sera celle des Anarchistes clandestins, actifs au second semestre 1919. Initié par le cheminot Casimir Kovalévitch et un groupe de vétérans de la Makhnovchtchina, ce réseau, qui se serait implanté dans une douzaine de villes, s’organise comme sous le tsarisme : un groupe de propagande doté d’une imprimerie clandestine ; un groupe de combat avec un atelier de fabrication d’explosifs ; un financement assuré par des braquages de banques.
Les Anarchistes clandestins réussiront un attentat spectaculaire le 25 septembre 1919, en lançant deux bombes dans une assemblée de hiérarques communistes à Moscou. Bilan : 12 morts et 58 blessés. Le réseau sera démantelé peu après par la Tchéka.

En mars 1921, la révolution connaîtra son ultime spasme, tragique, avec les grèves de Petrograd et le soulèvement solidaire de Cronstadt. Face à un pouvoir communiste déjà bureaucratisé et corrompu, l’insurrection des marins reprendra les mots d’ordre de la « troisième révolution » : pour des soviets librement élus et un socialisme égalitaire, sans privilèges de parti.
Mais ce bastion rouge restera isolé dans un pays épuisé par la guerre civile. Avec Cronstadt sera assassinée l’ultime tentative de renouer avec l’esprit révolutionnaire de Février et d’Octobre.
Guillaume Davranche (AL Montreuil)
et Pierre Chamechaude (Ami d’AL Paris nord-est)
Au sommaire du dossier :
- Février-mars 1917 : Après les tsaristes, chasser les capitalistes
- Avril-mai : L’irrépressible montée vers l’explosion sociale
- Juin-juillet : Provoquer une insurrection ne suffit pas
- Août-septembre : La contre-révolution creuse son propre tombeau
- Octobre rouge (et noir) : L’assaut dans l’inconnu
- Novembre 1917-avril 1918 : Du pluralisme à la révolution confisquée. Quatre points de clivage :
- Épilogue 1918-1921 : Résistance et éradication
- Bibliographie : Pour découvrir la Révolution russe
- Retrouvez également le podcast (64 minutes) sur Spectremedia.org