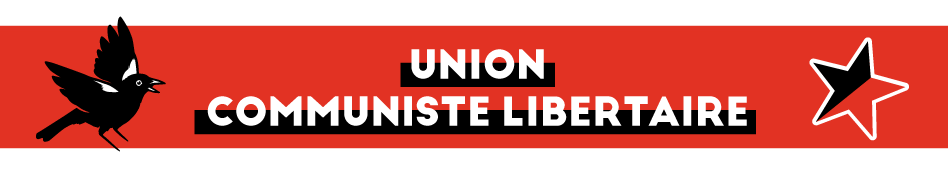Dossier 1917 : Une révolutionnaire ukrainienne : Maroussia sort de l’oubli
Dossier 1917 : Une révolutionnaire ukrainienne : Maroussia sort de l’oubli

Militante charismatique passée par la prison et par l’exil, formidable oratrice et cheffe de guerre, elle inspirait la terreur aux blancs et la méfiance aux rouges. Devenue, dans la culture soviétique, un personnage interlope et folklorique, elle est redécouverte depuis quelques années.

Nestor Makhno, qui fut entre 1918 et 1921 l’âme de l’armée paysanne insurgée d’Ukraine, n’a pas usurpé sa place dans la mémoire de l’anarchisme et de la Révolution russe. Mais il faut savoir que dans la représentation que l’URSS faisait de la Makhnovchtchina, Makhno était souvent flanqué d’un alter-ego féminin : « Banditka Maroussia ». La mémoire collective soviétique les a retenus comme un couple infernal de bandits de grands chemins, avides de sang et de rapines.
Tantôt représentée comme un garçon manqué, tantôt comme une traînée des campagnes, avinée et violente, Maroussia a réellement existé. Son vrai nom était Maria Grigorievna Nikifirova, et sa vie se situe aux antipodes de sa caricature.
Du terrorisme à l’exil
Née en 1885 à Alexandrovsk, dans la région d’Ekaterinoslav, elle passe son enfance à moins d’une centaine de kilomètres de Gouliaï Polié, qui deviendra la « capitale » de la Makhnovchtchina, en Ukraine méridionale. Fille d’un officier vétéran de la guerre de 1877-1878 contre la Turquie, rien ne la prédispose, en apparence, à devenir révolutionnaire. C’est pourtant ce qu’elle fait, dès ses 16 ans.
Les interprétations divergent cependant sur ce premier engagement. Les historiens proches du courant libertaire [1] le situent au sein de l’anarcho-communisme bezmotivnï (c’est-à-dire « sans motif » : pratiquant la violence indifférenciée contre les riches). Les publications issues des Archives russes la rattachent plutôt au courant socialiste-révolutionnaire [2].
Une chose est certaine : Nikifirova pratique la propagande par le fait, et multiplie les actions violentes. En 1908, elle est condamnée à vingt ans de travaux forcés pour l’assassinat d’un fonctionnaire municipal d’Alexandrovsk, mais elle parvient à s’évader de la prison de femmes de Moscou dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 1909.
Les chemins de l’évasion conduiront Maria, par étapes, à fuir l’empire russe par l’est. Une période de près de dix ans d’exil s’ouvre alors, des États-Unis à la France en passant par l’Angleterre, l’Allemagne, l’Espagne et la Suisse, au gré des opportunités et des rencontres. Elle forgera dans cette découverte du monde ses convictions politiques profondes, devenant définitivement anarchiste. Elle participe d’ailleurs, fin 1913, à Londres, à la conférence des anarcho-communistes russes en exil, et donne quelques articles à la presse libertaire russe de New York (Golos Trouda) et de Chicago (Vperiod).
Quand éclate la guerre, en 1914, elle se range derrière Kropotkine pour défendre l’Union sacrée de l’anarchisme avec le camp russo-anglo-français contre ce qui est identifié comme le danger suprême : l’impérialisme allemand.
Une cheffe de guerre anarchiste
On peut noter dans ce choix ce qui semble être un trait caractéristique de la personnalité de Maria Nikifirova : le goût pour l’action armée.
À son retour en Russie, en 1917, elle milite à la Fédération anarchiste communiste de Petrograd et, lors des journées de Juillet, elle va haranguer les marins à Cronstadt, pour les inciter à la mutinerie. Après l’échec de l’insurrection, elle retourne à Alexandrovsk. C’est là qu’elle apprendra le putsch d’Octobre.
En Ukraine, Maroussia, comme elle se fait appeler, met sur pied un bataillon de partisans anarchistes, la Volnaïa Boevaïa Druzhina (« Détachement militaire libre et volontaire ») qui dispose d’un train blindé orné de drapeaux noirs, affronte les factions contre-révolutionnaires et multiplie les expropriations-redistributions.
Ses qualités d’organisatrice, d’oratrice [3] et son caractère belliqueux sont repérés par Vladimir Antonov-Ovseïenko, qui assure le commandement militaire bolchevik en Ukraine. Il la considère comme bolchevo-compatible et interviendra à plusieurs reprises en sa faveur lors de ses déboires judiciaires. De son côté, Nikifirova et ses hommes s’allient aux gardes rouges pour renverser le soviet pronationaliste d’Alexandrovsk et lui substituer un soviet révolutionnaire.

Avec Nestor Makhno
Le divorce intervient en avril 1918, quand le gouvernement bolchevik brise le mouvement anarchiste. Ses excès – des actes de pillage – sont utilisés contre elle. Elle est arrêtée et l’Armée rouge entreprend de désarmer ses partisans.
L’anarchiste Apollon Kareline prend sa défense au Comité exécutif panrusse des soviets, mais c’est surtout Antonov-Ovseïenko qui la protège. En septembre 1918, au terme de deux procès, elle n’est condamnée qu’à une peine légère : la privation pour six mois de la possibilité d’exercer des fonctions au sein des soviets.
Entre janvier et le printemps 1919, en pleine terreur rouge contre les anarchistes, elle rejoint de nouveau Makhno pour quelques mois, assurant diverses fonctions au sein de l’armée insurrectionnelle qu’il a mise sur pied. Les Archives russes laissent entendre qu’elle aurait pu jouer un rôle intermédiaire entre l’Armée rouge et l’armée noire, et être employée à des missions secrètes et délicates.
C’est au cours de l’une de ces missions risquées en Crimée blanche, pour préparer un attentat contre l’état-major de Dénikine, qu’elle est arrêtée à Sébastopol, le 11 août 1919. Les blancs prennent le temps de la juger avant de la fusiller, à la mi-septembre 1919.
Maroussia n’est donc pas cette harpie caricaturée par la propagande soviétique ; elle n’est sans doute pas non plus une sainte (une « Jeanne d’Arc de l’anarchisme » comme la qualifie son biographe anglais). À la lumière des archives russes, une étude historique approfondie reste à mener sur Maria Nikifirova, anarchiste, oratrice et guerrière indomptable, ballottée par les vents contraires qui soufflaient sur la Révolution russe.
Pierre Chamechaude (Ami d’AL, Paris nord-est)
Au sommaire du dossier :
- Édito : Les anarchistes, leur rôle, leurs choix
- Février-mars 1917 : Après les tsaristes, chasser les capitalistes
- Avril-mai : L’irrépressible montée vers l’explosion sociale
- Juin-juillet : Provoquer une insurrection ne suffit pas
- Août-septembre : La contre-révolution creuse son propre tombeau
- Octobre rouge (et noir) : L’assaut dans l’inconnu
- Novembre 1917-avril 1918 : Du pluralisme à la révolution confisquée. Quatre points de clivage :
- Épilogue 1918-1921 : Résistance et éradication
- Bibliographie : Pour découvrir la Révolution russe