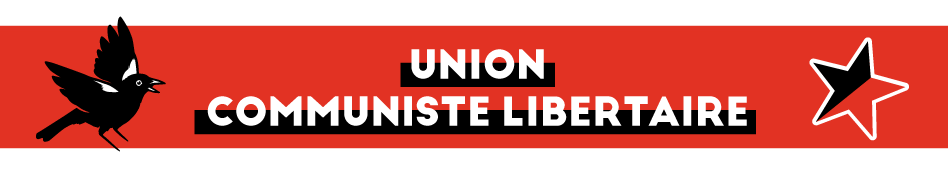Dossier 1917 : Août-septembre : La contre-révolution creuse son propre tombeau
Dossier 1917 : Août-septembre : La contre-révolution creuse son propre tombeau

La disgrâce de l’extrême gauche après l’échec de juillet n’aura pas été longue. Dès la fin août, le putsch avorté du général Kornilov la remet en selle, et déclenche une vague de terreur ouvrière contre la bourgeoisie. La guerre sociale ne fait que commencer. Pour les bolcheviks et leurs alliés anarchistes, la question du pouvoir est à l’ordre du jour.

L’échec démoralisant de l’insurrectionnalisme durant les journées des 3 et 4 juillet va avoir des conséquences aussi bien sur le Parti bolchevik que sur le mouvement anarchiste. Échaudés par un fiasco qui a fait fuir des milliers d’adhérents, les responsables bolcheviks de base éviteront désormais de se laisser entraîner par les anarchistes, et se montreront plus respectueux des directives de leur comité central.
Quant à la FAC, pourchassée et privée de son QG de la datcha Dournovo, son influence semble reculer au profit des anarcho-syndicalistes de l’UPAS. Du 18 au 22 juillet, une première conférence anarchiste se tient à Kharkov, avec des délégués de 12 grandes villes, et marque un tournant en se prononçant clairement pour la participation des anarchistes aux soviets [1].
Dans le même temps, l’UPAS clarifie les divergences avec les bolcheviks lors de la IIe conférence des comités d’usines de Petrograd, du 7 au 12 août.

L’ensemble des délégués veulent limiter la concurrence entre entreprises pour l’approvisionnement... mais pas de la même façon. Les anarcho-syndicalistes estiment que c’est le rôle de fédérations de comités d’usines, à structurer par branche d’industrie ; les bolcheviks estiment que ce sera la tâche d’un « État prolétarien » et déposent une motion en ce sens. Voline, délégué de l’usine Stein, s’y oppose. Mais la majorité bolchevisante des délégués rejette son objection, et vote la motion. Malgré tout, les anarcho-syndicalistes s’accrochent, et Chatov rejoint Maximov au comité central des comités d’usines de Petrograd.
Durant la conférence, les anarcho-syndicalistes ont d’ailleurs distribué le premier numéro de leur hebdomadaire, intitulé Golos Trouda, comme du temps de leur exil états-unien. Ils y défendent une autogestion socialiste fondée sur les comités d’usines, sans tutelle de l’État et, contrairement à la FAC, voient dans les soviets « les seules formes d’organisation de la démocratie révolutionnaire », les seules institutions à même de réussir la « décentralisation et la répartition du pouvoir » [2]. Golos Trouda atteindra un tirage de 25.000 exemplaires [3] ; à comparer aux 90.000 exemplaires quotidiens de la Pravda en juin 1917, auxquels il faut ajouter les 60.000 de la Soldatskaia Pravda [4].
S’appuyant sur leur journal, les anarcho-syndicalistes font des progrès. À Moscou, emmenés par un vétéran très influencé par le modèle français, Nicolai Lebedev, ils sont implantés chez les boulangers, les typographes, les postiers, les cheminots, les ouvriers du cuir et ceux du parfum. Plus au sud, ils gagnent les cimentiers et les dockers d’Ekaterinodar et de Novorossiisk. Chez les mineurs du Donbass, dès juin, une conférence a adopté le programme syndicaliste révolutionnaire des IWW. Enfin, fin août 1917, l’UPAS se prépare à inaugurer son premier club ouvrier dans le quartier de Vyborg, à Petrograd.
C’est à ce moment que la Russie est secouée par un événement qui va, de nouveau, accélérer la révolution : la tentative de putsch du général Kornilov.
Malgré lui, Kornilov relance la révolution
Depuis la répression des Journées de juillet, tout le monde s’attendait à un coup d’État pour « terminer le travail », remplacer Kerenski impuissant, liquider le Soviet de Petrograd, fusiller les « tovaritchtchi » menant le pays à sa perte et rétablir l’ordre. La bourgeoisie l’espérait intensément, la presse conservatrice y appelait ouvertement.
Leurs vœux sont exaucés lorsque la nouvelle se répand, le 29 août, que le général Kornilov marche sur Petrogard avec des troupes ramenées du front, dont les Cosaques de la « Division sauvage ». Au gouvernement, Kerenski, soupçonné de complicité avec Kornilov, ne peut faire autrement que de dénoncer cette sédition, et d’appeler à la résistance.
C’est alors que le pouvoir populaire va démontrer toute sa puissance, bien au-delà de ce qu’aurait souhaité Kerenski. Le péril Kornilov provoque un formidable sursaut non seulement à Petrograd, mais dans tout le pays. En Ukraine par exemple, dans une ville de 30.000 habitants comme Gouliaï-Polié, un Comité de défense de la révolution est aussitôt formé et, emmené par l’anarchiste Nestor Makhno, fait désarmer les bourgeois de la ville pour dissuader toute velléité de soutien à Kornilov [5].
Le Soviet de Petrograd, qui a appelé à la mobilisation générale, passe l’éponge sur les Journées de juillet : on libère les militants emprisonnés ; on ouvre les armureries ; on distribue des armes aux ouvriers ; on creuse des tranchées. La Garde rouge prend en mains la défense de la ville. L’anarchiste Justin Jouk, qui appartient à son comité directeur, fait livrer par la Poudrerie de Schlüsselbourg, une péniche de grenades que le Comité central des comités d’usines fait distribuer à Vyborg. On attend Kornilov de pied ferme.
En fait, il n’atteindra jamais Petrograd : privées de ravitaillement et de locomotion par les cheminots en grève, ses troupes sont immobilisées et, peu à peu, fraternisent avec les gardes rouges venus à leur rencontre. En quarante-huit heures, Kornilov est contraint d’abandonner la partie. La bourgeoisie est consternée ; les quartiers ouvriers exultent. Anarchistes et bolcheviks ont été au premier rang de la défense révolutionnaire ; pestiférés la veille, leur prestige est à présent au plus haut. Pour tout un chacun, il est clair que l’heure de la revanche a sonné.
La guerre sociale commence
Pour paraphraser Saint-Just en 1794, on pourrait dire que ceux qui font les contre-révolutions à moitié « ne font que se creuser un tombeau ». C’est exactement ce qui va se passer en Russie. Affolé par la tentative de putsch, le prolétariat va se défendre avec férocité. « Plus de sentiment, avait déclaré Jouk début août, plus de temps à perdre. L’heure est venue de frapper la bourgeoisie à la tête. » [6]

Alors que dans les campagnes, le mouvement d’appropriation des terres est allé crescendo depuis juin, c’est à présent dans les villes que les expropriations d’entreprises et de logements se multiplient. Les immeubles des beaux quartiers sont visités par des escouades de la Garde rouge, les bourgeois sont obligés de partager leurs vastes appartements avec des familles nécessiteuses, quand ils ne sont pas, tout simplement dépouillés de leurs biens de façon sauvage. Le Parti bolchevik lance le slogan « Pillez les pillards » véritable incitation à la reprise individuelle [7].
En ratant son putsch, Kornilov a déclenché une vague de terreur contre les classes possédantes en Russie. « C’est bien avant Octobre que les travailleurs révolutionnaires ont détruit la base du capitalisme. Il n’en restait que la superstructure politique », écrira Piotr Archinov dix ans plus tard [8].
De fait, l’existence du gouvernement provisoire ne tient qu’à un fil. Kerenski n’est plus pris au sérieux par personne. D’autant que les soviets l’ont lâché. Dès le 31 août, celui de Petrograd a condamné son ambiguïté vis-à-vis de Kornilov et a, pour la première fois, approuvé le mot d’ordre « Tout le pouvoir aux soviets ». Désavoués, les élus SR et mencheviks démissionnent du comité exécutif et y sont remplacés par une majorité bolchevik, emmenée par un Léon Trotski triomphant.
Dans les jours qui suivent, en province, plus de 50 soviets votent des mots d’ordre similaires. Le Parti bolchevik, identifié comme le parti de la révolution sociale, enregistre une progression spectaculaire, gagnant la majorité dans les plus gros soviets, mais aussi dans les syndicats où, jusqu’alors les mencheviks dominaient.
L’insurrection se prépare
Ne reste plus qu’à éliminer les modérés du VTsIK élu en juin. Un IIe congrès panrusse des soviets est convoqué pour octobre. Tout le monde pressent que les bolcheviks y seront majoritaires et que le congrès proclamera, enfin, la destitution du gouvernement provisoire. Il ne fait aucun doute que, s’il faut employer la coercition, on pourra compter sur les marins de Cronstadt, les soldats et les gardes rouges. Et que le Parti bolchevik sera le chef d’orchestre de l’opération.
Les militants bolcheviks et anarchistes s’entraînent au grand jour, dans les usines, avec les armes récupérées durant la Kornilovchtichna [9]. C’est de nouveau l’osmose, mais à présent sous le commandement incontesté du parti [10].

Dans la presse bolchevik, on débat ouvertement de l’insurrection. La grande question qui divise le comité central est celle du moment. Faut-il la lancer après que le congrès panrusse des soviets aura voté la destitution du gouvernement ? Ou bien faut-il la lancer avant, pour mettre le congrès devant le fait accompli ? L’enjeu non dit, mais de première importance, est de déterminer à qui échoira le pouvoir : directement au congrès des soviets, ou bien au Parti bolchevik, qui le transférerait ensuite aux soviets. L’enjeu est symbolique car, dans les deux cas, les bolcheviks seront le bras armé du congrès, appuyés par leurs alliés SR de gauche et anarchistes.
Mais le bras armé saura-t-il résister à la tentation de conserver le pouvoir pour lui seul ? Les anarchistes sont conscients du risque, mais pensent que la direction bolchevik n’aurait de toute façon pas les moyens de se maintenir seule au pouvoir.
À l’approche du congrès et de l’insurrection annoncée, Golos Trouda se prononce donc en faveur d’une « victoire des soviets » mais prévient : il faudra que le « parti politique aspirant au pouvoir et à la domination s’élimine après la victoire et cède effectivement sa place à une libre auto-organisation des travailleurs ». Faute de quoi, le nouveau gouvernement serait inévitablement renversé à son tour. Débuterait alors la « troisième et dernière étape de la révolution » : celle d’une « auto-organisation libre et naturelle des masses » [11].
De son côté, le journal de la FAC, Kommuna, qui souhaite ardemment l’insurrection, publie un programme signé Bleikhman en neuf points essentiellement économiques, mais qui reste vague sur l’exercice du pouvoir populaire – le mot « soviet » en est étrangement absent [12].
Guillaume Davranche (AL Montreuil)
Au sommaire du dossier :
- Février-mars 1917 : Après les tsaristes, chasser les capitalistes
- Avril-mai : L’irrépressible montée vers l’explosion sociale
- Juin-juillet : Provoquer une insurrection ne suffit pas
- Août-septembre : La contre-révolution creuse son propre tombeau
- Octobre rouge (et noir) : L’assaut dans l’inconnu
- Novembre 1917-avril 1918 : Du pluralisme à la révolution confisquée. Quatre points de clivage :
- Épilogue 1918-1921 : Résistance et éradication
- Bibliographie : Pour découvrir la Révolution russe
- Retrouvez également le podcast (64 minutes) sur Spectremedia.org