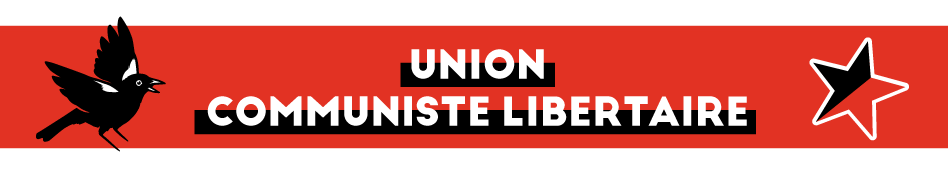« Transition » : les mensonges verts du lobby nucléaire
« Transition » : les mensonges verts du lobby nucléaire

Le 10 février, Macron annonçait la construction de six centrales EPR2, et éventuellement de huit EPR2 « additionnels ». Ces annonces suivent de très près le classement du nucléaire comme « énergie verte » par la Commission européenne, après un intense lobbying français. C’est un pas de plus vers une fausse transition écologique, sous le signe de l’atome.
L’électricité – à 70 % d’origine nucléaire – ne représente que 25 % de l’énergie consommée en France ; 65 % provient des énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon) et 10% est issue de la biomasse. Aussi, même si la France est de loin le pays le plus nucléarisé au monde, le pétrole y reste dominant, en particulier à travers le transport. La stratégie de l’État en matière de transition repose sur la montée en puissance du parc nucléaire et l’électrification massive du parc automobile. Cette stratégie n’a en fait rien de nouveau, il s’agit simplement d’une actualisation de l’électrification massive des années 1970-1980 qui visait à rendre la France moins dépendante des pays exportateurs de pétrole. Pourquoi appelle-t-on alors cela une transition ? Pour pouvoir retourner l’argument écologique contre le mouvement antinucléaire, et l’amener sur une controverse technique. Une tactique éprouvée depuis quarante ans, avec d’autres, comme la « transparence » revendiquée par le lobby nucléaire [1].
L’argument principal de ses partisans est que le nucléaire n’émet que très peu de gaz à effet de serre. Pour faire bonne mesure, sortons quelques chiffres. Et considérons l’ensemble de la filière, depuis la mine d’uranium jusqu’à la gestion des déchets. On estime l’intensité carbone moyenne à 65 grammes d’équivalent CO2 par Kwh d’électricité produit. On se situe donc largement en dessous des 600 à 1 200 g CO2 éq/kWhel des énergies fossiles… mais au-dessus des filières éolienne et hydroélectrique par exemple (autour de 20 g CO2 éq/kWhel) [2].
Le vrai bilan écologique
Il est important de revenir sur la notion d’« énergie verte ». Une approche qui se limite aux seuls gaz à effet de serre est aveugle aux problèmes écologiques qui épargnent les classes les plus aisées. En réalité, de nombreux villages, en particulier dans le Massif central et le Massif armoricain font face à de très graves problèmes sanitaires hérités de l’extraction de l’uranium [3].
Certes, il n’existe pas d’énergie propre, et ni le solaire ni l’éolien ne font exception. Mais les gens qui y travaillent ne subissent pas de radiations. Par ailleurs, les détracteurs des énergies renouvelables se plaisent à mettre en avant leurs coûts en terres rares, très polluantes, mais ces mêmes terres rares, et bien d’autres métaux dont l’extraction a des conséquences environnementales désastreuses, sont encore plus nécessaires à la construction des voitures électriques et d’un réseau capable de supporter la nouvelle puissance des centrales.
L’institution nucléaire
Depuis ses débuts, le nucléaire français a tout fait pour échapper aux concertations citoyennes. Aujourd’hui encore, le débat public sur la construction d’EPR a eu lieu alors que la décision gouvernementale de les construire était déjà arrêtée. La publication d’informations liées à la sécurité des futurs réacteurs par le réseau Sortir du nucléaire a valu à son porte-parole de se faire arrêter plusieurs fois et perquisitionner son appartement [4].
Les gouvernements progressistes passés au pouvoir ont pourtant cherché à réformer ces institutions, mais l’« atome transparent » est resté un élément de langage. Les comités locaux d’informations (CLI) par exemple, censés être la clef de voûte de ces réformes, sont soumis aux bon vouloir des exploitants de centrales qui filtrent l’information.
Lanceur d’alerte bâillonné au Tricastin
Suite à Tchernobyl, plusieurs associations de contre-expertise se sont montées pour dénoncer les mensonges du lobby nucléaire. Et à chaque révélation de leur part, il a fallu un véritable bras de fer pour faire éclater la vérité sur le danger auquel nous sommes exposées. On l’a encore vu récemment, lorsqu’un cadre « lanceur d’alerte », ostracisé par sa direction, a révélé que la centrale du Tricastin dissimulait systématiquement ses incidents à l’Autorité de sûreté nucléaire [5].

Le nucléaire est censé permettre à la France d’être indépendante énergétiquement… En quelque sorte ! Les bilans énergétiques des pays ne comptabilisent pas l’import-export de combustible, contrairement aux autres énergies. Or, la dernière mine française ayant fermé en 2001, l’industrie nucléaire importe tout son uranium. En 2020, il provenait à 35 % du Niger, à 29 % du Kazakhstan, à 26 % de l’Ouzbékistan et à 10 % d’Australie [6]. Les gisements nigériens et kazakhs sont exploités par des filiales du fleuron français Orano.
Au Niger, ancienne colonie française, ce pillage a nécessité la construction ex nihilo de villes minières de 100 000 habitantes et habitants sur d’anciennes terres pastorales. Les populations touarègues qui en avaient besoin pour vivre ont ensuite dû s’embaucher dans les mines françaises. Les conditions de travail y sont criminelles : la sous-traitance permet d’esquiver les exigences de sécurité même les plus basiques, comme la fourniture de gants. On relève des taux de contamination 10 fois supérieurs à la norme admise dans les eaux de la ville et jusqu’à 110 fois au sein des zones industrielles. Le recensement des ouvrières et ouvriers tués par l’industrie est d’autant plus compliqué que, pour éviter les scandales, Orano refuse d’équiper son hôpital avec le matériel nécessaire pour traiter les problèmes liés aux radiations malgré les demandes répétées des habitantes et habitants, et va même jusqu’à falsifier les dossier médicaux.
On peut ajouter à ça le fait que ces villes minières sont alimentées énergétiquement… en charbon, et que dans le cadre de ses opérations au Sahel, l’armée française garde les sites miniers. On comprend mieux que « souveraineté » est synonyme d’impérialisme et qu’« énergie verte » en Europe signifie asservissement et pillage au Niger [7].
Un débat politique et non technique
S’il faut retenir une chose, c’est qu’avant d’être un objet technique, le nucléaire est un projet politique. Un projet porté par une classe sociale qui se fiche bien de son effet sur les populations. Un projet conçu par et pour le productivisme, en dépit de toute considération écologique. Un projet qui alimente et est alimenté par la machine impérialiste française. Un projet qui gouverne par le secret et se refuse au débat démocratique.
Abolir le nucléaire et ses institutions est possible, il existe des scénarios de sortie qui peuvent servir d’inspiration comme le scénario NégaWatt [8], même si celui-ci est critiqué, y compris dans notre camp. Notre stratégie énergétique libertaire repose sur deux piliers complémentaires : le premier est l’autonomie des territoires, ceux-ci sont libres de décider quelle consommation sera la leur en organisant leurs besoins et comment y répondre. Le deuxième est la solidarité internationale qui, via un réseau électrique commun permettrait de réguler les fluctuations des énergies renouvelables. En laissant derrière nous la croissance et le productivisme, en recentrant la question sur nos besoins réels et en récupérant notre pouvoir sur comment y répondre, nous pourrons construire une société véritablement écologique.
Corentin (UCL Paris nord-est)