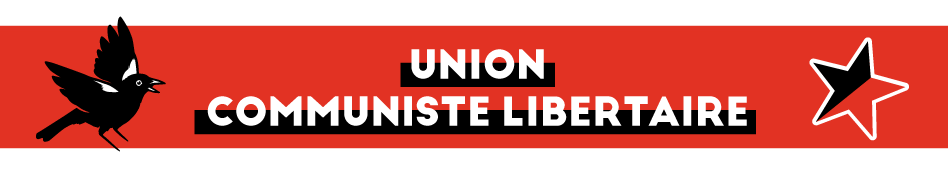L’espoir meurtri de la Commune de Paris
L’espoir meurtri de la Commune de Paris

Avec ce dossier spécial d’Alternative libertaire, à l’occasion des 150 ans de l’événement, il s’agit de le redécouvrir dans sa singularité, sans l’affubler d’oripeaux anachroniques.
Meurtrie, la Commune de 1871 le fut à plus d’un titre. Elle le fut par l’impitoyable répression de la Semaine sanglante. Elle le fut par les calomnies qu’on déversa sur elle, la réduisant à une « trahison » fomentée par des forces occultes. Elle le fut encore par le travestissement stalinien qui, à coups de burin, tâcha d’établir une filiation entre le mur des fédérés et la place du Colonel-Fabien, via l’URSS. Elle le fut par sa réduction, dans les manuels scolaires, à un épisode de guerre civile sans logique.
Mais meurtrie, elle le fut aussi un peu par un mouvement ouvrier trop friand d’images d’Épinal : barricades de pavés, baïonnettes et drapeaux rouges en lambeaux.
Or, la Commune de Paris fut un peu plus que cela.
Il importe de la redécouvrir dans sa singularité, sans l’affubler d’oripeaux anachroniques. Non, la Commune ne fut ni libertaire, ni socialiste, ni communiste. À l’image du mouvement ouvrier d’alors, elle fut à la fois patriote et internationaliste ; combattante et antimilitariste ; autogestionnaire et bureaucratique ; républicaine et prolétarienne ; socialiste et modérée… et férocement anticléricale. Elle respecta la Banque de France mais incendia les Tuileries. Peu féministe, elle fut pourtant un tremplin pour l’action féminine.

Le dossier que propose Alternative libertaire cherche à déchiffrer un moment clé de l’histoire des mouvements populaires d’émancipation. Il est bien sûr un hommage aux femmes et aux hommes dont l’espoir fut si grand qu’il nous inspire encore aujourd’hui. Mais mémoire et lucidité doivent aller de pair, et nous avons cherché à éviter autant la mythification que la condescendance. Quelles étaient les contradictions internes, les dynamiques, les limites ? Quelles leçons pour nous aujourd’hui, quels écueils éviter ?
Tout en refusant d’annexer la Commune de 1871 à l’histoire du mouvement anarchiste – qui ne naîtra qu’une décennie plus tard – nous nous sommes efforcées de l’analyser d’un point de vue libertaire. Jusqu’à quel point y eut-il une poussée du pouvoir populaire ? Y eut-il tentation de remettre en question la propriété privée des moyens de production et d’échange ? Pourquoi le « peuple en armes » fut-il ainsi terrassé par l’armée régulière ? Dans quelle mesure la hiérarchie hommes-femmes fut-elle altérée ? Quels étaient les principes éducatifs et démocratique en gésine ?
Laissons la dévotion aux dévots, l’amertume aux passéistes, et posons-nous les questions en révolutionnaires, à l’exemple des plus lucides des communardes et communards : les deux pieds fermement dans le présent et toute notre énergie tendue vers l’avenir.
Un dossier coordonné par Guillaume (UCL Montreuil) et Cuervo (UCL Marseille)
Sommaire
Crise prérévolutionnaire
- Les rouges prémices de la Commune
- Les tendances politiques qui vont animer la révolution
- L’AIT parisienne en ordre dispersé
Chronologie commentée
- 18 mars-28 mai : De la révolte montante à l’ultime barricade
Mémoire politique
- Quand les libertaires prenaient leurs distances
- Pour l’anarchiste Jean Grave, « La Commune légiférait, mais agissait peu »
- Gustave Lefrançais (1826-1901), entre communalisme et anarchisme
- La postérité internationale de l’idée de « commune »
Pouvoir populaire
- Commune, comités de quartiers, une dialectique inaboutie
- Mesures sociales : pas de révolution sans attenter à la propriété privée
Aspects éducatifs
Aspects féministes
- Serge Kibal (historien) : « Un début de reconnaissance des femmes comme individus libres »
Aspects militaires
- Pourquoi et comment les fédérés furent écrasés
- La garde nationale : une force politico-militaire autonome
- Lyon, Marseille... tentatives avortées
Bibliographie
- Rougerie, Tombs, Thomas... le drapeau rouge à chaque page